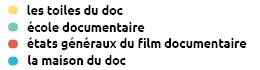2021
2021  Écrire – Dialogues
Écrire – Dialogues Écrire – Dialogues
Comment naissent les images ? Comment travaillent les images qui nous habitent, une forme du réel en nous, et comment la langue prend-elle forme ? Face à ces questions insondables, toute forme d’écriture est une hypothèse d’exploration, une tentative d’inscription ou de renoncement. Ces explorations sont des formes de confrontation au monde, des manières d’être au monde, des formes de vie, infinies.
« Écrire, c’est être devant le langage, devant les mots, physiquement », déclare Leslie Kaplan. Dans L’Image, un court texte vertigineux sans ponctuation, à lire à voix haute, Samuel Beckett modèle les mots comme une spirale désarticulée. Une seule phrase et sa voix résonne : « c’est fait j’ai fait l’image. »
Pour tenter de discerner, d’entendre ce qui se trame dans des gestes d’écriture, littéraires ou cinématographiques, nous accueillerons trois dialogues.
Un cinéaste, Emmanuel Falguières, dialoguera avec l’auteure Christiane Veschambre, personnage de son film. L’écriture est la matière même de Nulle part avant, tourné en partie en pellicule et fabriqué en laboratoire. Le film est un essai d’inscription que le réalisateur désigne comme « filmer l’écrire ». C’est aussi un essai sur la naissance des images, d’une langue, d’une musique, et une rencontre avec et entre trois femmes, trois histoires d’inscription. Comment naître à l’écriture ? Une quête qui les mène, elle et lui, sur les lieux du récit. Qu’y voit-on ? Ou plutôt, d’où ça parle ? Et d’où ça filme ? « Écrire, se tenir à ce lieu du vivant, c’est un travail », dit Christiane Veschambre à propos de l’écriture, approcher le « vivant de la vie » ou chez Dostoïevski « la vie vivante », « un passage de Vie qui traverse le vivable et le vécu » pour Deleuze, ou encore « la vie à l’état pur » dit Nathalie Sarraute. Des déclinaisons du mot « vie » pour indiquer que quelque chose bouleverse, touche au réel peut-être et se met, nous met, en mouvement.
Dans le roman Istanbul à jamais, le narrateur principal, Simon, réalisateur comme l’auteur lui-même, a parfois envie de filmer, « de fixer cette scène qui, se dit-il, n’aura plus jamais lieu ». Une autre forme d’exploration de l’écriture est celle de Samuel Aubin, porté par un vif désir de raconter des histoires, celles qu’il traverse, qu’il entend, qu’il regarde, et qu’il imagine, porté par ce désir de mise en fiction du réel, une façon d’habiter le monde. Pour Istanbul à jamais, où s’incarne sa relation à cette ville où il a vécu, il nous proposera un récit du cheminement de l’écriture, le « petit cinéma d’un roman » et l’on regardera le récit prendre forme. Avec Eva Chanet, son éditrice aux éditions Actes Sud, nous entrerons dans un deuxième mouvement de l’écriture. L’occasion pour nous d’aborder ce que peut être ce métier, la manière d’entrer en relation avec un texte, la sensibilité et l’engagement nécessaires face à la langue d’un auteur. Quel est ce lien singulier qui se construit de livre en livre entre l’écrivain et son éditeur ? Qu’est-ce qu’une langue ouvre en nous ?
Le troisième dialogue réunira le cinéaste Alexandre Barry et l’écrivain Arnaud Rykner, qui ont en commun d’avoir été tous deux assistants de Claude Régy. Pour le metteur en scène, « il s’agit de travailler pour que le texte fasse voir » et de « dire comme un langage jamais entendu ». Dans le film Trakl Sébastopol, Alexandre Barry nous expose à cette expérience troublante d’approcher le texte si éprouvant du poète Georg Trakl, qui nous parvient par le corps de l’acteur, traversé et quasi animé par le texte. Mouvement inverse évoqué par Arnaud Rykner pour Dans la neige : l’écriture, « c’est ce qu’un corps fait au langage » – formulation empruntée à Henri Meschonnic à propos de la poésie. Dans ce roman, le personnage se retire de l’écriture. Dans ce renoncement et son silence, on entendra peut-être ce que le monde fait au langage. Il leur importe à tous deux de « ne pas savoir », et d’espérer de leur écriture respective que quelque chose se révèle, non pas une épiphanie, mais un accident, un soubresaut, une surimpression.
En ouverture, nous regarderons L’Aventure de Mme Muir de Joseph L. Mankiewicz, un film auquel Christiane Veschambre consacre un chapitre de Basse Langue. Mrs. Muir cherche une maison à habiter. Elle y rencontre un fantôme et avec lui le récit d’une vie, dans une langue pour elle étrangère, à incarner. Puis dans le film rare Nathalie Sarraute, conversations avec Claude Régy, à propos d’un passage d’Enfance, la romancière s’interroge sur la manière de traduire ce moment de « vie à l’état pur » : « ces moments sont difficiles à montrer ». « Montrer », dit-elle…
Christophe Postic
Avec Emmanuel Falguières et Christiane Veschambre, Samuel Aubin et Eva Chanet, Alexandre Barry et Arnaud Rykner.
Les ouvrages de Christiane Veschambre ont paru aux éditions Isabelle Sauvage et Cheyne éditeur, les romans d’Arnaud Rykner aux Éditions du Rouergue, L’Image de Samuel Beckett aux Éditions de Minuit.
Emmanuel Falguières
Extrait de « Filmer l’écrire. À propos de Nulle part avant »
Christiane Veschambre se penche vers moi. Elle me dit que si, un jour, je veux faire un film de son recueil de poèmes Robert & Joséphine, elle en serait très heureuse. Je hoche la tête et souris, mais au fond je sais bien. Ces poèmes ont trouvé leur expression la plus sincère sur le papier. Je n’ai rien à transformer, rien à ajouter à ce texte fait pour être lu par chacun dans le silence de sa lecture. Je ne ferai pas de film. Et ainsi, je commence à faire un film.
Six ans plus tard, dans une petite salle plongée dans l’obscurité, je travaille à la dernière étape de fabrication de Nulle part avant. Je m’applique à découper les pages du livre de Robert & Joséphine. J’essaie de découper droit, comme à l’école. Je dépose la strophe d’un poème, bien à plat sur la grande table d’animation. La machine fait trop de bruit, même à l’arrêt. Perchée à un bon mètre au-dessus de la table, comme un héron curieux, la caméra 16 mm se penche vers la petite feuille de papier. […]
Pour que mon film existe, je suis parti de là : écrire à l’écran les poèmes de Christiane Veschambre, respecter le mot écrit, sa casse, le rythme visuel des vers et des strophes, la typographie des lettres. Une fois cela décidé, j’ai pu partir faire mon film en me sachant ancré, quelles que soient les dérives du travail du film.
Pour faire le film, j’ai commencé par aller voir Christiane pour parler longuement de son travail. Je venais chez elle à Paris et je l’interrogeais à la table avec une caméra numérique pour témoin, deux heures durant. Encore et encore, sur trois hivers. Faire un film en partant d’un texte devint faire un film sur un corps qui écrit, devint faire un film sur le corps de l’écriture. J’écoute Christiane, je lis Christiane, j’en oublie presque le cinéma. […]
L’écrire de Christiane est une fouille, une excavation de terres anciennes, et je lui demande de nous emmener, moi et ma caméra, au fond de ces terres. Pour cela, elle a droit à la parole, une parole qui s’invente au fur et à mesure des discussions. Je lui demande de retourner au lieu de son écriture sans son écriture, d’y retourner étrangère, m’y invitant pour que je puisse écrire mon film.
La Revue Documentaires n° 31, Films, textes, textures, 2021, p. 17.
Christiane Veschambre
Écrire a un problème : le langage.
En 1969, après avoir fait deux films, Marguerite Duras dit à Jacques Rivette : « Je ne peux plus lire de romans. À cause des phrases. »
Écrire doit avec les mots de la tribu faire apparaître, surgir, entendre, exister, lancer à la traverse du vivant parlant ce que la musique, la peinture, la danse, lancent à travers lui sans les mots.
Quelque chose vient qui n’a pas de mots, que les phrases vont repousser au néant, qui me fait seule, qui m’éprouve, et c’est Écrire. Écrire seul. Seul Écrire.
L’enfant apte à la langue que j’ai tôt été – parler, lire, écrire –, l’enfant claire, n’avait pas de prise sur l’obscure présence d’une femme sans alphabet, d’un contenant de terre qui l’infusaient. Ce n’est pas par la bouche que ça passait, pas par la main, le cerveau, mais par la masse ; l’enfant gracile et claire s’imprégnait, non, s’infusait, c’est bien le mot, d’une impondérable masse sombre, dont la vie ignorée sédimentait en elle ses couches primaires en silence.
La femme sans alphabet, à la nuit tombée parfois, se mettait en route, en chemin de traverse, en chemin creux, on la retrouvait errante, on la ramenait à sa maison de terre, on lui lisait la lettre qu’elle avait reçue. Elle errait une lettre à la main.
Ce n’est pas moi qui lui ai lu la lettre mais j’ai dû écrire celles qu’elle m’enjoignit de tracer, lorsque depuis longtemps elle avait cessé de vivre dans la maison de terre, et que l’enfant lettrée dut accueillir Écrire, enfant sauvage, écarté de la tribu, venu d’en deçà de la langue.
Elle lui fit un livre en langue. Un livre où régner seul, comme la femme obscure en son silence.
Écrire n’existe qu’en langue, mais en langue-seule. Qu’il faut chercher seul, en longeant la haie de la langue acquise (en contrebas, ou en la franchissant, s’y écorchant), chassé du parc qui entoure le château de la littérature, abêti par la solitude – celle d’une femme sans alphabet ni raisonnement traversant la lande déjà sombre.
Écrire / Un caractère, éditions Isabelle Sauvage, Coat Malguen, 2018, p. 44.
Samuel Aubin
Je pourrais l’appeler Petit cinéma d’un roman. Ce serait une sorte de film éphémère, il n’aurait lieu qu’une seule fois. Au départ, il y a eu l’idée de faire coexister Istanbul à jamais, roman écrit au retour de quatre années en Turquie, avec des plans tournés au hasard d’un repérage. J’avais aussi retrouvé dans un disque dur quelques images faites à la volée, parfois au téléphone, avec le simple désir de capter l’esprit d’un lieu, d’un moment. Mais comment ces images et le livre pouvaient-ils dialoguer, comment pouvais-je les mettre en relation sans que les unes soient l’illustration de l’autre ?
J’ai ouvert mes carnets, écrits à Istanbul entre 2014 et 2018, et j’y ai trouvé d’autres images, croquées avec des mots dans mon quotidien, au café, dans les vapur, chez moi, partout, saisir l’instant en écrivant, le fixer. Avec l’idée, à peine formulée, de puiser un jour dans ces notes pour écrire un livre. Je ne savais pas ce qu’il s’y raconterait, il y avait ces années folles où la Turquie approchait un peu plus chaque jour de la guerre civile, les attentats, les copains et copines en procès, parfois emprisonnés. « Notre œil trouve dans le monde sa raison d’être, et notre esprit s’éclaire en se mesurant à lui », écrit Philippe Jaccottet dans L’encre serait de l’ombre. Il fallait faire exister à nouveau le vécu, le vu, le ressenti, et faire passer par la langue, travailler la matière des mots pour rendre la matière du monde. C’est peut-être ça raconter, pas forcément construire une histoire, mais donner des éléments de sensations, des segments de vécu, avec lesquels le lecteur chemine, trace une ligne, reconstitue un possible récit.
D’où cette proposition aujourd’hui, un écran partagé en deux, d’un côté des bribes saisies avec ma caméra, de l’autre quelques pages de mes carnets et la lecture que j’en fais. Un diptyque où dialoguent deux régimes d’images, où apparaît en filigrane l’hypothèse d’un roman, puis sa genèse et son écriture, jusqu’à l’envoi de quelques manuscrits à des maisons d’édition. Un jour, plus tard, une éditrice m’a téléphoné, « Êtes-vous prêt à travailler votre texte ? » Le début d’une autre histoire.
Eva Chanet
Recevoir un texte, le sentir, lire dans l’instant quelques pages qui d’emblée semblent s’imposer. Quelques pages dont la justesse de ton est une évidence, l’écriture une exigence ; dont le propos – ou ce que j’imagine au fil de ces toutes premières pages être le propos – semble une nécessité.
Le roman de Samuel Aubin est arrivé sous un autre titre, en mars 2019, il s’intitulait : Istanbul demeure.
Un titre que j’ai entendu comme une promesse : Istanbul demeure.
Quelques pages seulement et déjà le manuscrit glisse dans mon sac, gage de lecture prochaine, de lecture complète face aux impératifs du jour.
Plus tard je commence, il me faut lire, annoter, écouter le texte se déployer, devoir et plus encore chercher à entendre l’impensé, ce qui se dessine sans encore apparaître. Des heures de lecture, souvent à voix haute, lentement je relis des passages, prends des notes, des pages de notes. Tel est mon travail d’éditeur.
Puis, si la conviction s’installe totalement, vient l’instant de l’appel téléphonique, dire à celui, à celle qui attend, que son manuscrit est intéressant, lui dire pourquoi. Lui dire aussi parfois qu’une part du récit pourrait peut-être bouger, aller plus loin, sûrement. Entendre sa réaction, espérer, deviner sa confiance.
Le lien entre l’auteur et l’éditeur se profile dès cet échange téléphonique, puis la première rencontre est fixée, l’histoire peut alors commencer.
Des heures d’échanges, des versions retouchées, un ouvrage de dentellière : la confiance s’immisce. Le lien se tisse, se noue livre après livre, se resserre. Car un premier livre publié par l’éditeur doit être le premier d’une longue série, c’est ce qu’il pressent à la première lecture du texte, et c’est aussi ce qu’il espère.
L’éditeur et l’écrivain, un chemin partagé. Une complicité singulière.
Alexandre Barry
L’écriture de mes films prend son temps. Ça écrit en moi, ça me malaxe sans pause. C’est d’un ordre non clair puisque j’écris sans écrire. L’écriture est un mouvement sans but, qui me porte, pas à pas, jour après nuit, vers de l’inconnu. Elle respire à partir de strates qui s’accumulent et se soustraient les unes aux autres. Aucune stabilité, aucun repère. Elle ne peut se construire, pour rester vivante, qu’en se détruisant. En moi s’agitent des rêves d’images qui s’agrègent à des lieux, à des visages, à des intuitions, à des lueurs dans la nuit. Des visions « cul par-dessus tête » défilent au ralenti dans un bain opaque et m’indiquent une voie étroite sur laquelle mon instinct s’engouffre. Un alphabet primitif et silencieux. Saisies par mon œil intérieur, ces visions subaquatiques m’ouvrent à un désir de rencontre, de sublimer un être ou une œuvre qui m’a hissé au-delà de moi-même. Ce que j’essaie de filmer est un amas d’obsessions. Des psychoses merveilleuses : comment s’approcher au plus près d’un visage et rendre sensible son mystère sans pour autant le dévoiler ? Comment dépasser la surface du réel, la faire craquer et atteindre une vie secrète qui se révèle en restant secrète ? Pour que ce secret devienne le sujet même d’un film ? Une contradiction foncière anime pourtant ce cheminement obscur de l’écriture. Car une conscience extrême et une hypra lucidité se mêlent à ce non-savoir. Peut-être se rejoignent-ils dans une zone de l’esprit où connaissance et ignorance se confondent.
Nathalie Sarraute, conversations avec Claude Régy, un film de Claude Régy, découvert en 1995. Son dispositif : un visage, une parole reliée à son centre de gravité, des questions posées par une voix dont le visage hors-champ se sur-imprime sans apparaître à celui qui remplit l’image. Je prends conscience aujourd’hui, vingt-cinq ans après, que dans Trakl Sébastopol j’ai filmé ce visage qui écoute. Sans le savoir, j’étais parti à sa recherche.
C’est l’invisible, l’image manquante que l’on traque. Que sait-on alors de ce qu’on écrit ? En persistant dans ma recherche aveugle, je peux seulement espérer que l’endroit d’où ça écrit, d’où ça filme, puisse rejoindre l’endroit d’où ça voit, d’où ça rêve, d’où ça écoute. L’écoute, c’est depuis cet état que l’écriture, quelle que soit sa forme, peut advenir. Mais écouter quoi ?…
Arnaud Rykner
Pourquoi écrire ? Peut-être n’est-ce qu’une sale manie : tracer des mots, brasser du vent.
Pourtant, écrire pour moi n’est peut-être qu’une tentative un peu désespérée de me taire tout à fait, de faire taire le langage en moi, et de faire advenir autre chose que des mots – fût-ce grâce aux mots. En quoi la peinture et le cinéma me semblent l’horizon inatteignable de la littérature et du théâtre.
Peut-être est-ce en lisant Maeterlinck que j’ai compris à quel point le langage que nous sommes condamnés à utiliser, quand nous voulons « communiquer », est impuissant à le faire :
« Et dans le domaine où nous sommes, ceux-là même qui savent parler le plus profondément sentent le mieux que les mots n’expriment jamais les relations réelles et spéciales qu’il y a entre deux êtres. […] dès que nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire […]. » (Le Trésor des humbles, « Le silence », 1896)
Condamné au langage, par la nature de sa pratique, l’écrivain est donc aussi condamné au silence par la faiblesse du même langage (aussi sophistiqué soit-il), incapable de recueillir le foisonnement et la brutalité du Réel. Car de quoi peut-on « parler » sans parler à côté de ce dernier, ou, pire, sans le couvrir du bruit parasite de la langue ? Hofmannsthal le dit aussi :
« Car c’est quelque chose qui ne possède aucun nom et d’ailleurs ne peut guère en recevoir, cela qui s’annonce à moi dans ces instants, emplissant comme un vase n’importe quelle apparence de mon entourage quotidien d’un flot débordant de vie exaltée. »
C’est là le paradoxe fondateur d’un « quelque chose qui ne possède aucun nom » et « ne peut guère en recevoir », mais que l’écrivain tente de faire advenir malgré les mots. Paradoxe d’une parole faite pour laisser en elle-même un espace de silence où tenter de loger le monde.
Il faudrait mettre alors bout à bout la phrase de Derrida et celle de Wittgenstein à laquelle elle répond :
« Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. »
« Ce qu’on ne peut dire, il faut l’écrire. »
Ou mieux peut-être : le filmer. Faute de savoir le faire, je continue d’écrire, espérant arriver un jour vraiment à me taire.