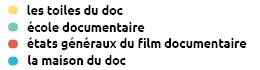2022
2022  Gênes 2001. Une mémoire de l'avenir (séminaire 1)
Gênes 2001. Une mémoire de l'avenir (séminaire 1) Gênes 2001. Une mémoire de l'avenir (séminaire 1)
Début 2020, Pietro Marcello, Francesco Munzi et Alice Rohrwacher entamaient le tournage d’un film à travers l’Italie, Futura, à la rencontre de garçons et de filles pas encore sortis de l’adolescence, pour les écouter raconter leurs rêves et leurs visions de l’avenir. Hasard ou mauvais présage, leur film fut interrompu par la pandémie de Covid-19 et devint du même coup un témoignage inédit sur une génération confrontée à un futur qui paraissait soudain plus incertain. Ce n’est pourtant pas pour ses lendemains qui déchantent que le film m’a interpellée, mais pour une espèce d’amnésie du passé qui surgit de manière inattendue au détour d’une séquence. À Gênes, Alice Rohrwacher discute avec des lycéens de la Scuola Diaz. Elle évoque son émotion au souvenir de la tragédie du contre-sommet du G8 qui s’est jouée entre ces murs, dans la nuit du 21 juillet 2001. Silence surpris de ses interlocuteurs. Aucun n’a connaissance des faits, et le G8 ne leur évoque que de vagues récits de ville fortifiée pour accueillir les chefs des États les plus puissants de la planète. Elle leur raconte alors le raid de la police dans l’école qui abritait le centre des médias alternatifs et où dormaient cette nuit-là une centaine de personnes. L’un d’entre eux semble se souvenir de l’histoire d’un garçon qui avait été tué ailleurs dans la ville, mais sans doute le garçon, comme ceux qui dormaient dans l’école, avaient-ils des choses à se reprocher, car on n’est jamais victime de répression policière sans raison. En 2021, ces jeunes gens de l’école Diaz, qui n’étaient pas nés il y a vingt ans, ne peuvent imaginer qu’on puisse être battu et massacré sans avoir commis quelque crime, tandis qu’Alice Rohrwacher, qui avait une vingtaine d’années en 2001, ne peut revenir à Gênes sans voir resurgir les images d’une ville transformée en champ de bataille où les forces de l’ordre confondaient les manifestants altermondialistes avec l’ennemi. L’écart entre la mémoire douloureuse d’un côté, et l’amnésie ou l’ignorance de l’autre, se mesure à l’aune de cette incompréhension réciproque, qui témoigne peut-être moins de la différence des générations et de la dépolitisation d’une partie de la jeunesse (après tout, il y a sans doute d’autres jeunes gens du même âge que ceux-ci qui n’ignorent rien des événements de 2001) que de la conflictualité des mémoires et de ce qu’on n’hérite pas des mêmes blessures ni de la même histoire.
Retour à Gênes
Quels récits subsistent de ces journées de mobilisation de juillet 2001 ? Quelles mémoires en ont été transmises ? Quelles images en constituent l’archive collective ? Celles et ceux qui y étaient ne savent pas toujours par où entamer leurs récits. Pour certains, Gênes fut l’aboutissement d’un répertoire d’action militant aussi bien que de logiques médiatiques et policières qui s’étaient sédimentés au fil des contre-sommets – à Seattle en 1999, à Prague en 2000 ou encore à Göteborg en juin 2001, où la police suédoise avait tiré à balles réelles sur les manifestants. Pour d’autres, elle fut une fête désenchantée, qui devait sonner le glas du mouvement altermondialiste né deux ans plus tôt : « Aujourd’hui, il faudrait cheminer à rebours, retrouver le souvenir des petites routes alpestres parcourues dans un rêve puéril de clandestins. (…) Un été 2001. Cela commence comme un teen movie, les affects jetés en vrac.[1] » Moment fondateur et rupture, creuset de modes d’action et traumatisme, histoire de la violence et affects militants, Gênes fut tout cela à la fois. En déplier l’héritage aujourd’hui n’est pas chose aisée, d’autant qu’aucune action judiciaire n’a permis d’en exorciser les blessures : il y a bien eu par exemple un « procès de l’école Diaz » en 2008, lors duquel des responsables de la police italienne ont été condamnés pour coups et blessures et falsification de preuves (on avait trouvé dans l’école des cocktails Molotov dont il fut ensuite prouvé qu’ils avaient été introduits par les policiers eux-mêmes). Aucun d’entre eux n’a cependant purgé sa peine, exemptés par une loi d’amnistie de 2006. À la différence des policiers, dix militants ont été poursuivis et lourdement condamnés pour avoir causé des dommages matériels, en vertu d’une loi « dévastation et saccage » héritée du régime de Mussolini. Parmi eux, Vincenzo Vecchi, résidant dans un petit village du Morbihan, fait aujourd’hui encore l’objet d’une demande d’extradition par l’Italie. Mais l’héritage de Gênes ne concerne ni ses seuls protagonistes ni les événements du passé, car cette histoire nous parle du présent : celui d’une « stratégie de la tension » érigée en modèle de contrôle social, celui de violences policières qui se comptent en morts et en mutilés, celui d’une « bataille des images[2] » qui a vu s’ériger l’une contre l’autre la rhétorique de la preuve et le soupçon complotiste à travers les usages médiatiques, politiques et judiciaires des images.
Toute chronologie est une fiction
Dans un livre de 2015, Mathieu Riboulet parcourt la longue décennie des années soixante-dix à travers quelques souvenirs et voyages fondateurs de sa vie politique et intime. Cette chronologie sans logique autre qu’affective déroule un fil ténu, celui des victimes de violence d’État. « Je me refuse absolument à faire comme si rien ne s’était passé, comme si de 1967 à 1978 il n’y avait pas eu au cœur même de l’Europe en paix cette déflagration de violence qui laissa dans les rues les corps de centaines d’hommes et de femmes abattus comme des chiens.[3] » La séquence historique découpée par Riboulet a des ramifications plus profondes : on pourrait en chercher l’origine du côté des communards ou bien des partisans italiens, et en sonder les échos dans le mouvement des Gilets jaunes ou celui des No-Tav de la vallée de Suse. Mais cette chronologie éclatée et subjective vise moins l’exactitude historique que la tentative de faire sens d’une expérience et d’une trajectoire, biographique aussi bien que politique. Car au fond toutes les chronologies sont des fictions : « Les heures ne sont pas les mêmes pour tout le monde, la chronologie est une fiction. Une balle tirée à bout portant en pleine rue.[4] » Des secondes qui s’étirent en durées, des heurts qui semblent répéter des scènes déjà advenues, des images qui saisissent par accident des destins individuels et collectifs. À Gênes, toute tentative chronologique se trouve d’emblée prise dans le présent subjectif du témoignage (où la reconstitution des faits échoue souvent à se mettre au diapason du temps objectif) et dans le temps long de l’histoire. La mort de Carlo Giuliani, abattu par un carabinier, rejoue celle de Giorgiana Masi, tuée à Rome le 12 mai 1977, la théâtralité photogénique des Tute Bianche, et la rationalité tactique non moins photogénique des Blacks Blocs, n’appartiennent pas aux mêmes registres d’action, et ce n’est pas sans raison que le collectif d’écrivains italiens Wu Ming inscrit la bataille contre le G8 dans un imaginaire millénariste et dans la tradition des Jacqueries médiévales.
Une « mémoire de l’avenir »
Revenir à Gênes aujourd’hui, c’est ainsi conjuguer ensemble passé, présent et futur, car si les chronologies sont des fictions, alors elles peuvent révéler des coïncidences historiques et devenir des enjeux de lutte plutôt que des successions consensuelles et des continuités monotones. C’est rouvrir une archive colossale pour mesurer les distances historiques et politiques qui nous séparent de ce moment « Gênes 2001 » et nous en font cependant les héritiers. C’est remonter le temps à rebours du présentisme des médias quand ils réduisent un événement à un titre et quelques mots-clefs, pour découvrir d’autres régimes d’historicité et des narrations divergentes. C’est arpenter un corpus visuel qui se conjugue à plusieurs temps : car ces images forment ce que Michel Foucault appelait une « mémoire de l’avenir[5] ». Si elles permettent de reconstituer avec précision le déroulé des jours, la cartographie des cortèges et jusqu’au parcours d’un individu (Francesca Comencini, dans son film consacré à Carlo Giuliani, retrace heure après heure la journée du jeune homme à partir de photographies et de vidéos), elles engagent simultanément une vision plus vaste et complexe que le récit officiel : non, disent-elles, Gênes ne fut pas une fête sabotée par des militants violents qui débordèrent les forces de l’ordre. Toutes ces images montrent le caractère irréductible de l’événement. Toutes résistent aussi à l’interprétation. Après Seattle en 1999, les manifestations du contre-sommet du G8 ont été les premières en Europe à se trouver saturées d’appareils de prise de vue. Au lieu de constituer un ensemble de témoignages et de preuves, ces images ont déterminé un nouvel espace de contestation, où s’affrontent les versions contradictoires des manifestants et forces de l’ordre, et à l’intérieur même de la manifestation, les partisans d’une voie légaliste et pacifiste et les autres.
Revenir à Gênes, c’est sonder ces images et les narrations contrariées qu’elles soutiennent, tenter d’aller au-delà de leur effet de sidération pour comprendre leurs usages réels et symboliques sur des scènes judiciaires et politiques où elles se trouvent sommées de – et bien souvent échouent à – faire la lumière. Le corpus iconographique entourant la mort de Carlo Giuliani engage à une telle expérience du regard : photographies de presse et vidéos amateurs ont saisi l’instant de ce drame, films de montage, archives en ligne et graffiti en perpétuent la mémoire. La force et la fragilité d’un projet tel que celui qu’entreprend Francesca Comencini en 2002 quand elle réalise Carlo Giuliani Ragazzo, tient à la difficulté de définir sa position, ni hagiographie, ni pure chronique documentaire, mais tragédie dont la récitante est une mère endeuillée (Haidi Giuliani) et le chœur une multitude en colère. Dans son roman Ça change quoi (Seuil, 2010), Roberto Ferrucci lui aussi tente de retrouver la mémoire à partir de ses propres archives photographiques et audiovisuelles et des clichés iconiques de la presse. Et de s’interroger : ces images et ces sons, pourquoi se substituent-ils à nos propres expériences ? Comment façonnent-ils nos êtres profonds et nos choix politiques ? Comment nous révèlent-ils à nous-mêmes ?
Quand, à son tour, la documentariste sonore Adila Bennedjaï-Zou retourne à Gênes où elle s’était rendue vingt ans plus tôt avec un collectif, c’est dans l’espoir d’élucider l’expérience vécue de la mobilisation et de la violence, et de ce que l’une et l’autre ont fait aux vies de ceux qui étaient alors à Gênes. Le témoignage et l’archive permettent ensemble de saisir quelque chose des émotions embrouillées qui trament une telle expérience : l’amour, la peur, la joie et la colère s’y mêlent indistinctement. Si l’archive agit ici comme symptôme, c’est qu’elle demande à être rouverte, déconstruite, débattue. Elle agit comme une langue vernaculaire, dont il faut trouver la traduction en récit, tant militant que judiciaire. La constitution d’un fonds inédit par son ampleur et la diversité de ses formats – documentaires, vidéos militantes, rushes de télévisions locales ou encore enregistrements audio des communications radio de la police – par le cinéaste Carlo Bachschmidt peut dès lors s’entendre comme une entreprise non d’institutionnalisation mais de relecture critique de ce matériau : collecter et conserver, oui, mais pour opérer le travail que les institutions politiques et judiciaires n’ont pas accompli, rouvrir plutôt qu’enfouir la mémoire. Quels enjeux historiographiques et critiques recouvre une telle démarche ? À qui s’adresse-t-elle ? Quelles résonances entretient-elle avec d’autres histoires de violence passées et présentes ? Parmi les lectures les plus fécondes de ces archives, il n’y a pas seulement celles des contemporains de Gênes, mais aussi le travail de jeunes gens qui héritent de cette histoire dans un moment politique désespérant : c’est le propre d’une pièce de théâtre créée en 2021 par la compagnie L’Onde, Entre les deux il y a Gênes, adaptation de Gênes 01 de Fausto Paravidino (L'Arche, 2005) traversée de fragments du livre de Mathieu Riboulet. Gênes y opère la jonction entre deux époques, les années 1970 et 2020, où les récits de violence d’État fondent les expériences politiques. Il y a là une manière d’engager un autre dialogue avec l’archive et d’opérer des coupes dans l’histoire pour en percevoir les répétitions tragiques, les héritages sans testament, et peut-être aussi des horizons d’espoir.
Alice Leroy
Coordination : Alice Leroy
Avec Carlo Bachschmidt, Adila Bennedjaï-Zou, Maxime Boidy, Marie Fabre, Dario Marchiori
Séance du mardi 23.08, 10:00 : « Gênes, médias, medium » avec Carlo Bachschmidt.
1. « Genova 2001 – Prises de vues », in Collectif Mauvaise Troupe, Constellations. Trajectoires révolutionnaires du jeune 21e siècle, Éditions de l’Éclat, 2014, p. 71.
2. Voir Sylvie Lindeperg, Nuremberg. La Bataille des images (Payot, 2021), et Dork Zabunyan, Fictions de Trump, puissances des images et exercices du pouvoir (Point du jour, 2020).
3. Mathieu Riboulet, Entre les deux il n’y a rien, Verdier, 2015, p. 15.
4. Ibidem, p. 11-12.
5. Michel Foucault, « Anti-Rétro », Cahiers du cinéma, n°251-252, juillet-août 1974, repris dans Dits et Écrits, II, 1970-1975, Paris, Gallimard, 1994, p. 648.