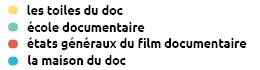2023
2023  Filmer les procès, filmer la justice... l’image juste ?
Filmer les procès, filmer la justice... l’image juste ? Filmer les procès, filmer la justice... l’image juste ?
Filmer les procès, filmer la justice... l’image juste?
En URSS dès les années vingt, l’État fit filmer les procès auxquels Lénine prêtait une vertu pédagogique « d’éducation du peuple ». Pendant la période stalinienne, le cinéma soviétique devint un redoutable auxiliaire de justice à l’occasion des jugements de la grande terreur. Au fil de ces tournages naquit un genre cinématographique qui fut réactivé en 1943 à Kharkov, lors du premier procès de criminels nazis qui constitua le prélude soviétique de Nuremberg.
Le grand procès international de Nuremberg, ouvert en novembre 1945, fut construit et mis en scène par les États-Unis. Il fut également filmé par les militaires du Signal Corps américain, les opérateurs des actualités occidentales et l’équipe soviétique du cinéaste Roman Karmen. Trois films, trois regards, trois destins d’une archive qui est loin d’être une matière brute ou un document univoque.
Quinze ans plus tard, le procès Eichmann fit entrer pour la première fois la justice dans l’ère de la télévision : les audiences furent filmées intégralement en vidéo par le documentariste américain Leo Hurwitz, en vue d’alimenter les journaux et les émissions télévisés de par le monde. La singularité de ce filmage tient à la totale liberté que les juges de Jérusalem laissèrent au cinéaste. Usant de toutes les ressources de la grammaire cinématographique – zooms, mouvements de caméras, jeux d’échelle alternant plans d’ensemble et très gros plans fragmentant l’espace et les corps –, Hurwitz chercha à faire du téléspectateur un observateur surpuissant.
C’est une conception du filmage et une philosophie de la justice diamétralement opposées qui s’imposèrent en France à la fin des années quatre-vingt. La loi Badinter y autorisa sous condition le filmage intégral de procès présentant un intérêt pour « la constitution d’archives historiques de la justice ». Depuis le procès Barbie (1987) jusqu’à celui de l’attentat de Nice (2022), l’application de cette loi repose sur un idéal de neutralité et une promesse illusoire d’objectivité. Les équipes techniques reçoivent pour consigne de suivre le fil de la parole en se focalisant sur les orateurs ; les plans d’écoute ne sont tolérés qu’à titre « tout à fait exceptionnel » ; le public n’est jamais filmé.
C’est dans ces conditions qu’a été enregistré le procès des attentats du 13 novembre 2015 (stade de France, terrasses et Bataclan) dont nous avons suivi les audiences. Aujourd’hui, avec la loi de 2021 sur « la confiance dans la justice », Éric Dupont-Moretti rêve de faire des traces filmées un spectacle télévisuel qui ferait entrer les gestes de la justice dans les foyers des téléspectateurs français.
Ainsi se pose un premier problème qui est celui de l’enregistrement et de la destination des images filmées vers un public prêt à consommer le crime, les plaidoiries, les condamnations comme les amnisties. Qui « tient » la caméra ? Que fait-elle voir et que dissimule-t-elle ? Qui est maître des images, de leur cadrage, de leur hors-champ ?
En réinscrivant le procès du 13 novembre dans l’histoire et en rendant compte de notre expérience de spectatrices ayant suivi les débats dans le prétoire et sur les écrans de retransmission des salles annexes, nous réfléchirons à la manière dont les outils audiovisuels ont renforcé les pouvoirs du président de la Cour en matière de police de l’audience tout en réduisant la spontanéité des prises de parole. En concertation avec la Chancellerie, le président Périès décida ce qui était donné à voir et ce qui devait ne pas être montré.
Le problème qui se pose alors est double. Il engage d’abord la question de l’invisibilité de toute personne qui ne parle pas (par exemple les accusés quand ils n’ont pas la parole, les parties civiles et les spectateurs du « public citoyen »). Le président décida par ailleurs quels documents photographiques et filmés sur les attentats du 13 novembre pouvaient être projetés à l’audience. Le second problème dès lors soulevé est celui de la preuve. Les images peuvent-elles ou non opérer dans un tribunal à titre de preuve ? Nous poserons, dans le même mouvement d’analyse de la « preuve judiciaire », la question de la fiction en introduisant dans notre réflexion quelques films exemplaires (dont Bamako d’Abderrahmane Sissako). D’une façon générale, le questionnement englobera la relation du cinéma à l’exercice de la justice et la construction de la place politique ou émotive du spectateur. Inévitablement le questionnement devient politique.
Nous débattrons de tous ces problèmes et de bien d’autres en les partageant avec le public auquel seront proposés un certain nombre d’extraits de films de procès pouvant nourrir nos interrogations plutôt que des positions affirmées (images des procès soviétiques, de Nuremberg, du procès Eichmann ; films réalisés à partir de ces rushes par Vertov, Karmen, Hurwitz, Perlov, Sivan ou encore Loznitsa).
Ce séminaire entend questionner une situation particulièrement vive en ce moment où la violence engendrée par des crimes semble être le symptôme d’une mise en question de l’institution judiciaire elle-même. Face aux vidéos criminalisantes ou criminalisées, comment penser une pratique cinématographique et éclairante de l’exercice de la justice quand le flot des images de toute origine risque de se placer sur le terrain d’une justice populaire ?
Sylvie Lindeperg et Marie José Mondzain
Le séminaire est prolongé par une séance spéciale avec le film El Juicio de Ulises de la Orden (mercredi 23.08, 10:00, Salle des fêtes).